19/02/2026
La Spectralisation de l'Angoisse

Ποταμῷ οὐκ ἔστιν ἐμπήσειν δὶς τῷ αὐτῷ,
On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve
Héraclite
I
Le spectacle ne meurt pas ; il mute. Ce qui fut organisation de l'apparence pour produire l'assentiment par l'éblouissement devient aujourd'hui orchestration de la terreur pour obtenir la soumission par le tremblement. La séparation achevée ne se contente plus de transformer le vécu en représentation ; elle fait de l'angoisse elle-même la substance du lien social. Là où régnait autrefois la promesse illusoire de l'abondance, s'installe désormais la menace permanente de l'effondrement.
L'économie spectaculaire, parvenue à son stade terminal, découvre que la fascination pour la marchandise s'épuise. Le désir fabriqué rencontre ses limites matérielles et psychiques. Les vitrines, même infiniment renouvelées, ne suffisent plus à capter l'attention fragmentée des spectateurs épuisés. Mais le spectacle ne capitule jamais ; il se réinvente. Puisque l'adhésion par l'enchantement faiblit, il faut obtenir l'obéissance par l'effroi. Le sujet qui ne consent plus à être consommateur consentira à être survivant.
Cette métamorphose ne relève d'aucune conspiration cachée, mais d'une logique immanente au système de domination spectaculaire. Lorsque l'accumulation marchande ne peut plus se légitimer par ses promesses de jouissance, elle doit se justifier par la protection qu'elle prétend offrir. Le pouvoir séparé, qui organisait hier les satisfactions, administre aujourd'hui les menaces. La gestion des populations bascule de l'incitation à la consommation vers la gestion de la survie collective.
II
L'angoisse climatique constitue le paradigme parfait de cette mutation. Non que la perturbation des équilibres écologiques soit imaginaire — elle procède directement de la production industrielle que le spectacle a mondialisée — mais sa mise en spectacle obéit à une économie politique de la peur. L'apocalypse environnementale fonctionne comme horizon permanent, suffisamment proche pour justifier toute mesure d'urgence, suffisamment lointaine pour ne jamais advenir tout à fait.
Le compte à rebours est devenu la figure centrale de ce nouveau régime d'images. Douze ans, dix ans, huit ans avant le point de non-retour : la temporalité catastrophiste remplace la temporalité progressiste qui structurait l'ancien spectacle. Là où celui-ci promettait un futur radieux par l'accumulation de marchandises, celui-là brandit un futur inhabitable que seule l'obéissance présente peut conjurer. Dans les deux cas, le présent vécu se trouve confisqué au profit d'une projection qui légitime la passivité.
La jeunesse spectacularisée pleure rituellement devant les caméras sa planète mourante. Ces larmes constituent un spectacle dans le spectacle : l'angoisse exhibée devient preuve de conscience, et la conscience ainsi démontrée dispense de toute action véritable. Car l'action, dans ce théâtre de l'angoisse, se réduit précisément à la participation aux cérémonies de la peur collective. Manifester son effroi, c'est déjà agir. Le ressenti affiché remplace la transformation effective.
Les dirigeants séparés, réunis dans leurs sommets internationaux, miment la préoccupation dans une chorégraphie soigneusement réglée. Ils arrivent en jets privés pour parler de sobriété, échangent des engagements chiffrés qui ne seront jamais tenus, puis repartent en ayant consolidé leur légitimité de gestionnaires de la catastrophe annoncée. Le spectacle climatique ne vise pas à résoudre la crise écologique, mais à en faire le fondement d'une gouvernementalité renouvelée.
Cette gouvernementalité exige du spectateur-citoyen qu'il intériorise la culpabilité. Chaque geste quotidien devient potentiellement criminel : le trajet en voiture, le repas carné, le chauffage en hiver. La responsabilité de la destruction écologique, qui incombe structurellement à l'organisation spectaculaire-marchande de la production, se trouve atomisée et redistribuée sur les individus séparés. Chacun doit expier par des gestes symboliques — trier ses déchets, acheter « vert », réduire son « empreinte » — ce que le système produit globalement.
III
L'épisode sanitaire de 2020-2022 a représenté le laboratoire grandeur nature de cette gestion par la terreur. Une maladie réelle, dont la létalité concernait principalement les personnes très âgées et déjà fragilisées, fut transformée en menace existentielle absolue justifiant la suspension de toute vie sociale normale. Le spectacle sanitaire atteignit alors une intensité inédite : chaque individu devint potentiellement mortel pour tout autre, et cette létalité supposée légitima l'assignation à résidence de populations entières.
La peur ne fut pas spontanée mais méthodiquement fabriquée. Les images de cercueils défilant en boucle, les chiffres quotidiens de décès martelés comme des incantations, les experts défilant sur les plateaux pour prophétiser des hécatombes : tout concourut à produire l'état d'exception psychique nécessaire à l'acceptation de mesures qui, quelques mois auparavant, auraient été rejetées comme relevant du despotisme. Le confinement généralisé, impensable dans les sociétés prétendument libérales, s'imposa comme évidence sanitaire.
Ce qui frappe rétrospectivement, c'est la simultanéité mondiale de cette réponse. De Melbourne à Milan, de Toronto à Tel-Aviv, les mêmes protocoles furent appliqués avec des variations mineures, comme si une partition unique était interprétée sur tous les continents. Cette synchronisation spectaculaire révéla l'existence d'une infrastructure de pouvoir transnational capable de coordonner la panique et d'uniformiser les comportements à l'échelle planétaire.
Le masque devint le symbole parfait de cette mutation. Objet hygiénique d'efficacité discutable pour la population générale, il fonctionnait excellemment comme signe d'adhésion au récit sanitaire. Porter le masque manifestait la soumission à l'injonction collective, la reconnaissance de la menace officielle, l'acceptation de la transformation de chaque corps en vecteur potentiel de mort. Inversement, le refus du masque signalait l'hérésie, la dissidence, le refus de communier dans la peur partagée.
La vaccination de masse contre un virus à la mortalité stratifiée par âge et comorbidités fut présentée comme devoir citoyen absolu. Non seulement chacun devait se faire injecter un produit expérimental, mais l'injection devint condition d'accès à l'espace social. Le « passe sanitaire » instaura un régime de ségrégation médicale où les corps certifiés conformes pouvaient circuler, tandis que les autres se voyaient exclus des lieux de vie collective. Cette biopolitique spectaculaire franchit un seuil : le corps individuel cessait d'appartenir à l'individu pour devenir propriété de la collectivité sanitaire gérée par l'État.
Toute interrogation sur la proportionnalité des mesures, toute critique de leur efficacité, toute mise en doute de la narratif officiel furent immédiatement qualifiées de « complotisme ». Ce terme magique permettait de disqualifier toute pensée critique sans avoir à y répondre. La société du spectacle atteignait là sa perfection : la réalité était devenue indiscutable parce que spectaculaire, et le spectacle indiscutable parce qu'identifié à la réalité elle-même. Contester le spectacle sanitaire revenait à nier la maladie, donc à vouloir la mort d'autrui.
Ce qui survécut à la pandémie ne fut pas un bilan critique de cette gestion catastrophique, mais la normalisation des outils de contrôle expérimentés durant cette période. Le traçage numérique, la surveillance sanitaire, l'exclusion des non-conformes, la restriction de la mobilité : autant de procédures désormais disponibles dans la boîte à outils du pouvoir séparé, prêtes à être réactivées lors de la prochaine « urgence ».
IV
Le conflit ukrainien a fourni un autre terrain d'expérimentation à cette gestion par la peur, cette fois sur le registre géopolitique. Une guerre régionale, certes brutale mais comparable à d'autres conflits contemporains largement ignorés, fut érigée en confrontation manichéenne absolue entre le Bien démocratique et le Mal autoritaire. La nuance devint trahison, l'analyse devint complaisance, la contextualisation historique devint propagande hostile.
Le régime de Kiev, autoritaire et oligarchique, corrompu et répressif envers ses minorités et ses opposants, fut miraculeusement transfiguré en bastion de la civilisation occidentale. Ses dirigeants, hier encore dénoncés pour leurs dérives, devinrent héros immaculés qu'il fallait aduler sans réserve. Toute mention de l'histoire complexe de l'Ukraine, de ses fractures internes, du rôle des formations néo-nazies intégrées dans son appareil sécuritaire, de l'expansion de l'OTAN comme facteur de déstabilisation : tout cela fut effacé par le spectacle d'une nation martyre incarnant les « valeurs » occidentales.
L'adhésion à cette narratif devint obligatoire. Les drapeaux ukrainiens fleurirent sur les façades officielles, les réseaux sociaux incorporèrent les couleurs bleu et jaune dans leurs logos, les célébrités se photographièrent en tenue militaire folklorique. Ce spectacle de solidarité performative ne coûtait rien aux performeurs mais signalait leur appartenance au camp du Bien. Comme toujours dans le spectacle, l'apparence de l'engagement dispensait de l'engagement réel.
La peur nucléaire fut réactivée, ressuscitant les angoisses de la Guerre froide pour une génération qui ne les avait pas connues. Le risque d'escalade atomique, réel mais savamment instrumentalisé, servit à justifier un soutien inconditionnel au régime ukrainien : toute critique, toute suggestion de négociation devenait « munichoise », appeasement face au nouvel Hitler. L'invocation de 1938 fonctionna comme elle fonctionne toujours dans le spectacle : en bloquant la réflexion par l'analogie émotive.
Ce qui apparaît avec ce conflit, c'est la capacité du spectacle à fabriquer des identifications passionnelles instantanées. Des populations qui hier ignoraient tout de l'Ukraine se découvrirent « toutes ukrainiennes », prêtes à accepter les conséquences économiques du conflit — inflation, pénuries énergétiques — au nom d'une solidarité abstraite avec un pays dont elles ne savaient rien quelques mois auparavant. Le spectacle avait réussi à transformer un conflit géopolitique complexe en mélodrame moral où chacun devait choisir son camp.
L'alternative présentée était simple : soutenir Kiev inconditionnellement ou être objectivement complice de Moscou. Comme toujours, le spectacle fonctionne par dichotomies manichéennes qui excluent toute position tierce. Analyser les responsabilités multiples dans le déclenchement du conflit, critiquer simultanément l'invasion russe et le bellicisme occidental, refuser de choisir entre deux impérialismes : ces positions devenaient impensables dans l'espace spectaculaire.
V
Le terrorisme a toujours été le complément nécessaire du spectacle de la sécurité. Les attentats meurtriers, réels dans leur horreur, fonctionnent comme moments de resserrement de la communauté spectaculaire autour de ses symboles et de ses interdits. L'émotion collective, soigneusement orchestrée, permet de légitimer l'extension continue de l'appareil sécuritaire et la restriction corrélative des libertés formelles.
L'attentat contre Charlie Hebdo en janvier 2015 inaugura en France ce régime permanent de l'exception sécuritaire. L'assassinat de dessinateurs et de journalistes, acte d'une barbarie incontestable, fut immédiatement spectacularisé en symbole de l'attaque contre la « liberté d'expression ». Des millions d'individus défilèrent derrière des chefs d'État, certains représentant des régimes où cette liberté n'existe pas, brandissant des pancartes « Je suis Charlie » dans une communion spectaculaire de défense de valeurs dont le spectacle lui-même organise quotidiennement le vidage.
Ce qui ne pouvait être questionné, sous peine d'être accusé de justifier le massacre, c'était précisément les zones d'ombre de l'événement. Comment des hommes sous surveillance ont-ils pu préparer et exécuter une opération paramilitaire en plein Paris ? Pourquoi certaines pistes d'investigation furent-elles rapidement abandonnées ? Quels liens entretenaient les assaillants avec les services de renseignement ? Poser ces questions équivalait déjà à basculer dans le complotisme, c'est-à-dire à refuser la version spectaculaire de l'événement.
L'enquête elle-même parut étrangement bridée, certaines zones restant délibérément inexplorées. Mais dans la société du spectacle parvenue à maturité, la vérité factuelle importe moins que la vérité spectaculaire. Ce qui compte n'est pas ce qui s'est réellement passé mais la narratif qui en sera extraite et qui servira de fondement à de nouvelles restrictions, à de nouveaux dispositifs de contrôle. L'événement réel n'est que le prétexte du spectacle qui le prolonge et qui, seul, possède une efficacité politique.
Le terrorisme fonctionne ainsi comme épouvantail permanent justifiant l'état d'urgence perpétuel. La menace, constamment rappelée mais jamais précisément localisée, entretient un climat d'anxiété diffuse qui rend acceptables des mesures autrefois impensables. La fouille sans motif, la surveillance généralisée, la délation encouragée, le fichage préventif : autant de procédures normalisées au nom de la protection contre un ennemi insaisissable.
Cet ennemi doit rester suffisamment menaçant pour légitimer l'appareil sécuritaire mais pas assez puissant pour mettre réellement en danger le système. Le terrorisme spectaculaire n'est jamais révolutionnaire ; il est toujours, in fine, fonctionnel à la consolidation du pouvoir qu'il prétend combattre. Ses attaques meurtrières contre des civils, moralement indéfendables, servent objectivement la domination en fournissant les chocs émotionnels nécessaires à l'acceptation de la servitude.
Après la fable climatique, la tromperie sanitaire, la menace russe, le capitalisme, mortel comme tout système et en crise sans solution prépare son nouveau Grand Guignol, toujours bouc émissaire de tous les malheurs, E.T. ! Le Royaume-Uni doit planifier une crise financière qui se déclencherait si le gouvernement américain annonçait l'existence d'étrangers, a déclaré sans rire un ancien expert de la Banque d'Angleterre. Helen McCaw, qui a été analyste principale en sécurité financière à la banque centrale du Royaume-Uni, a écrit à Andrew Bailey, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, l'exhortant à prévoir des éventualités au cas où la Maison Blanche confirmerait l'existence d'une vie extraterrestre, selon le Times. Plus le mensonge est gros, plus il passe. N'oublions pas l'histoire de La Guerre des mondes dramatique radio interprétée par la troupe du Mercury Theatre et diffusée le sur le réseau CBS aux États-Unis, écrite et racontée par Orson Welles, ayant semé la panique chez certains Américains. Ne rencontre t-on pas parfois des naïfs (à la maison on use d'un autre nom) porteurs de masque dans la rue ?
VI
La gestion de l'information dans ce régime spectaculaire de la peur révèle une mutation profonde. Là où la propagande classique cherchait à convaincre, la gestion spectaculaire de l'information vise à saturer. Il ne s'agit plus de faire croire à une version des faits, mais de rendre impossible toute élaboration critique par la multiplication des stimuli anxiogènes.
Le flux informationnel continu, accessible sur tous les écrans, ne produit pas de connaissance mais de l'étourdissement. Chaque « actualité » chasse la précédente avant qu'elle n'ait pu être digérée. L'urgence permanente interdit la réflexion. Le spectateur-citoyen, bombardé de menaces multiples et changeantes, ne peut que réagir émotionnellement sans jamais accéder à la compréhension.
Cette saturation anxiogène s'accompagne paradoxalement d'une uniformisation du discours autorisé. Les médias spectaculaires, malgré leur apparente pluralité, diffusent des variations sur un même thème. Les débats organisés opposent de fausses alternatives qui partagent les mêmes présupposés. L'illusion du choix dissimule le consensus sur l'essentiel.
Toute voix dissidente se voit immédiatement marginalisée, non par la censure directe qui serait trop visible, mais par la disqualification préalable. Le dissensus n'est pas interdit ; il est rendu inaudible en étant immédiatement associé aux catégories infamantes : complotisme, extrémisme, populisme. Ces termes magiques permettent d'évacuer tout contenu critique sans avoir à l'examiner. Ils fonctionnent comme des stigmates qui suffisent à invalider toute parole.
Le fact-checking, présenté comme rempart contre la désinformation, participe de cette police du discours. Des officines prétendument neutres s'arrogent le droit de décréter le vrai du faux, souvent sur des questions complexes qui exigeraient débat contradictoire. La « vérité » devient ce qui a été certifié conforme par ces instances autorisées, lesquelles dépendent structurellement du système spectaculaire qu'elles prétendent assainir.
VII
L'individu pris dans ce régime spectaculaire de la peur subit une double dépossession. D'abord dépossédé de sa capacité à agir sur le monde, réduit au statut de spectateur impuissant des catastrophes annoncées. Ensuite dépossédé de sa capacité à penser librement, sommé d'adhérer aux narratifs officiels sous peine d'exclusion symbolique.
Cette double dépossession produit des subjectivités particulières. L'anxiété chronique devient l'état mental normal. Chacun intériorise la menace permanente et développe des stratégies d'évitement plutôt que de confrontation. La prudence obsessionnelle remplace l'audace ; la conformité protectrice remplace la critique ; la recherche de sécurité illusoire remplace l'aspiration à la liberté.
Le spectacle de la peur produit aussi ses héros négatifs : les climato-sceptiques, les antivax, les pro-russes, tous ceux qui refusent d'adhérer aux paniques programmées. Ces figures repoussoirs permettent à la majorité conformiste de se rassurer sur sa propre vertu. En se démarquant de ces parias, le spectateur-citoyen acquiert la preuve de sa rectitude morale et de son intelligence critique, alors même qu'il ne fait que répéter les mots d'ordre du spectacle.
Cette production d'ennemis intérieurs est essentielle au fonctionnement du système. Le danger ne vient plus seulement de l'extérieur — le terroriste, le dictateur étranger, le virus — mais de l'intérieur même de la société. Le voisin non-vacciné, le collègue climatosceptique, le proche qui questionne la narratif ukrainienne : autant de menaces domestiques qui justifient la vigilance mutuelle et la délation bienveillante.
La société atomisée se recompose ainsi en une communauté négative, rassemblée non par un projet commun mais par des peurs partagées et des rejets identiques. Ce qui lie les spectateurs entre eux n'est pas l'amour du même mais la haine du différent, non l'espoir d'un futur meilleur mais la terreur d'un futur pire.

« Cette démocratie si parfaite fabrique elle-même son inconcevable ennemi, le terrorisme. Elle veut, en effet, être jugée sur ses ennemis plutôt que sur ses résultats. L'histoire du terrorisme est écrite par l'État ; elle est donc éducative », Guy Debord.
Charlie Kirk est un golem ayant échappé à ses créateurs, devenu proche du catholicisme et solidaire de la Palestine,. incontrôlable car refusant l'argent, toujours plus populaire, il devient une menace pour de nombreux intérêts intérieurs et extérieurs aux USA., Son exécution publique, à l'enquête bloquée depuis des mois, permet désormais de vendre en son nom une politique et des valeurs inversant celles qu'il défendait et d'alimenter en prime un juteux commerce digne d'un parc d'attractions.
VIII
L'efficacité de ce régime spectaculaire de la peur réside dans sa capacité à s'auto-justifier. Chaque mesure prise au nom de la protection contre les menaces crée de nouvelles conditions qui semblent valider ces menaces. Le confinement sanitaire a détruit des pans entiers de l'économie, créant pauvreté et détresse psychologique qui justifient rétrospectivement la gravité supposée de la crise initiale. Les sanctions économiques contre la Russie ont provoqué une inflation qui confirme apparemment que nous sommes bien en guerre.
Ce système s'auto-entretient par prophéties auto-réalisatrices. Les mesures censées prévenir les catastrophes les produisent, ce qui légitime l'extension de ces mêmes mesures. La spirale anxiogène s'accélère : plus on prétend combattre les menaces, plus on en crée de nouvelles qui exigent de nouvelles interventions.
Le spectacle de la peur se nourrit ainsi de ses propres échecs. L'inefficacité des politiques climatiques, loin de discréditer le narratif catastrophiste, le renforce : si la situation empire malgré nos efforts, c'est que nous n'en faisons pas assez. L'échec des confinements à enrayer durablement l'épidémie ne remettait pas en cause leur principe mais appelait à les multiplier. L'enlisement du conflit ukrainien ne suggère pas de négocier mais d'envoyer davantage d'armes.
Cette logique infernale ne peut que s'intensifier. Chaque crise « gérée » par la peur appelle la suivante, chaque urgence normalisée prépare l'urgence suivante. Le spectacle de la peur fonctionne comme une addiction : il faut des doses croissantes pour obtenir le même effet de sidération et d'obéissance.
IX
Pourtant, ce système rencontre des résistances. Non des résistances organisées — celles-ci sont immédiatement repérées et neutralisées — mais des formes diffuses de non-adhésion, de retrait, de désaffection. Une partie croissante de la population cesse simplement de croire aux spectacles successifs de la peur. Non qu'elle développe une analyse critique articulée, mais elle ressent confusément la manipulation, la disproportion entre les menaces brandies et la réalité vécue.
Cette incrédulité spontanée, le spectacle la nomme « fatigue pandémique », « climato-scepticisme », « complotisme », toujours en termes pathologiques qui suggèrent un dysfonctionnement de ceux qui doutent plutôt qu'un mensonge de ceux qui imposent le récit. Mais cette incrédulité persiste et s'étend, malgré les efforts de rééducation médiatique.
Le spectacle de la peur se heurte aussi à ses contradictions internes. On ne peut simultanément exiger des populations qu'elles consomment pour sauver l'économie et qu'elles se privent pour sauver la planète. On ne peut prétendre défendre la démocratie en Ukraine tout en piétinant les libertés fondamentales au nom de la santé publique. Ces contradictions, soigneusement compartimentées dans l'espace spectaculaire, finissent par devenir visibles.
Surtout, la gestion par la peur atteint ses limites psychologiques. L'anxiété permanente épuise. L'angoisse sans issue débouche sur l'apathie ou la révolte. Le spectateur constamment terrorisé finit par développer une forme d'immunité émotionnelle, un endurcissement qui le rend moins manipulable. La peur comme instrument de gouvernement souffre d'un rendement décroissant.
X
Que faire face à ce régime spectaculaire de la peur ? La question elle-même est piégée, car elle appelle une réponse positive, un programme, une stratégie, alors que la première tâche est négative : cesser de participer au spectacle, refuser l'adhésion aux narratifs anxiogènes, se désintoxiquer du flux informationnel permanent.
Ce refus n'a rien d'une fuite. Il est au contraire la condition préalable de toute action véritable. Tant qu'on reste captif des peurs fabriquées, on ne peut qu'obéir aux injonctions qui prétendent conjurer ces peurs. Se libérer du spectacle de la peur signifie d'abord reconquérir la capacité d'évaluer par soi-même les menaces réelles, de distinguer les dangers effectifs des épouvantails agités.
Cette reconquête de l'autonomie de jugement passe par la reconstruction de liens non-spectaculaires. Face à la communauté négative rassemblée par la peur, il faut opposer des communautés réelles fondées sur la coopération concrète et la solidarité effective. Le spectacle prospère sur l'isolement ; la vie réelle exige l'association.
Elle passe aussi par la critique impitoyable de toutes les variantes du spectacle, y compris de celles qui se présentent comme oppositionnelles. Le spectacle sait récupérer ses propres critiques, fabriquer de fausses dissidences qui canalisent la révolte vers des impasses. La critique spectaculaire de la société spectaculaire reste spectaculaire. Seule une critique qui s'enracine dans une pratique différente peut échapper à cette récupération.
La fin du spectacle de la peur ne viendra pas d'une prise de conscience collective soudaine, d'un grand soir informationnel où les écailles tomberaient des yeux des masses. Elle viendra, si elle vient, de la multiplication de pratiques qui rendent le spectacle superflu parce qu'elles organisent la vie réelle sur d'autres bases. Partout où des individus cessent d'être spectateurs pour redevenir acteurs de leur propre existence, le spectacle perd sa prise.
Cette perspective n'a rien d'optimiste. Les forces du spectacle sont immenses, l'emprise du fétichisme marchand sur les esprits est profonde, l'habitude de la servitude est bien ancrée. Mais l'histoire n'est pas écrite d'avance, et le spectacle, malgré son apparente toute-puissance, reste vulnérable à ce qui lui échappe : la vie non-spectaculaire, l'expérience directe, la pensée critique véritable.
Le spectacle de la peur représente peut-être le dernier stade avant l'effondrement du spectacle lui-même. En renonçant à séduire pour se contenter de terroriser, le pouvoir séparé avoue son épuisement. Il ne parvient plus à faire rêver, seulement à faire trembler. Cette dégradation contient peut-être, en creux, la promesse de son dépassement.
Ce qui est certain, c'est que le choix s'impose avec une netteté croissante : vivre dans la peur spectaculaire ou vivre tout court. Continuer à être spectateur de catastrophes fabriquées ou redevenir sujet de sa propre histoire. Obéir aux gestionnaires de l'angoisse ou reconquérir la capacité collective de transformer réellement le monde. Entre ces alternatives, aucune neutralité n'est possible. Le spectacle de la peur exige l'adhésion totale ou appelle la sécession radicale.
L'heure n'est plus aux illusions réformistes. On ne réformera pas le spectacle de l'intérieur, on ne l'humanisera pas par de bonnes intentions. On ne le convaincra pas de renoncer à la terreur pour revenir à la séduction. Il faut le dépasser entièrement ou périr avec lui. Cette alternative, voilà peut-être la seule chose qui ne soit pas spectaculaire dans notre époque : le choix entre la vie réelle et la mort spectaculaire se pose désormais sans médiation possible. De ce choix, effectué individuellement et collectivement, dépend tout ce qui peut encore advenir d'humain.
07:56 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook | | |
Facebook | | | 
11/02/2026
Configuration PC 2026 recommandée (3/3)

Le Moniteur : iiyama G-Master Black Hawk GB3482WQSU-B1, Pièce Maîtresse
Nous y voilà. Le composant qui monopolisera votre regard 8 heures par jour. Celui qu'on garde 7-10 ans. Celui dont la qualité impacte directement confort visuel, productivité, plaisir de jeu. Ne lésinez JAMAIS sur l'écran.
Format Ultrawide 21:9 : Révolution ou Gadget ?
3440x1440 pixels en ratio 21:9. C'est 33% de largeur supplémentaire versus un 16:9 classique en 1440p. Concrètement :
Gaming : champ de vision élargi immersif (simulateurs, FPS, RPG open-world). Dans un jeu comme Microsoft Flight Simulator, vous voyez l'habitacle complet sans bouger la caméra. Dans un FPS, périphérie visuelle augmentée (avantage compétitif débattu).
Productivité : deux fenêtres côte à côte confortablement (Word + Chrome, Premiere Pro + Finder, code + documentation). Plus besoin de double écran pour beaucoup.
Cinéma : films natifs 21:9 (Scope 2,39:1) s'affichent sans bandes noires. Immersion maximale.
Inconvénient : tous les jeux ne supportent pas nativement le 21:9. Certains affichent des barres noires latérales ou déforment l'image. Depuis 2020, 85% des jeux AAA supportent l'ultrawide. Les récalcitrants (Nintendo ports, certains jeux japonais) nécessitent parfois des mods communautaires. Pour du gaming compétitif pur (CS:GO, Valorant), certains préfèrent le 16:9 classique 1440p 240 Hz. Mais pour notre usage polyvalent, l'ultrawide est magique.
Spécifications Techniques de l'iiyama GB3482WQSU-B1
Taille : 34 pouces (86 cm diagonale)
Résolution : 3440x1440 (UWQHD)
Dalle : VA (Vertical Alignment) incurvée 1500R
Taux rafraîchissement : 120 Hz
Temps réponse : 0,6 ms MPRT (Moving Picture Response Time)
Luminosité : 500 cd/m² (nits)
Contraste : 3000:1 typique (VA oblige)
Gamut colorimétrique : 95% DCI-P3, 125% sRGB
Technologie Adaptive Sync : FreeSync Premium (compatible G-Sync via DP)
Connectivité :
- 1x DisplayPort 1.4
- 2x HDMI 2.0
- USB Hub (2x USB 3.2 Type-A, 2x USB Type-C)
Ergonomie :
- Pied réglable en hauteur (15 cm)
- Inclinaison : -5° à +20°
- Rotation : ±30° (swivel)
- Pivot : non (logique vu la largeur)
Haut-parleurs intégrés : Oui, 2x3W (basiques mais présents)
Dalle VA vs IPS vs TN : Le Débat Éternel
TN (Twisted Nematic) : temps de réponse ultrarapide (1 ms), taux rafraîchissement élevés (360 Hz), angles de vision catastrophiques, couleurs médiocres. Pour gaming compétitif pur exclusivement.
IPS (In-Plane Switching) : angles de vision excellents, couleurs précises, temps réponse correct (4-5 ms natif, 1 ms avec overdrive), contraste faible (~1000:1), fuite de lumière (IPS glow) en scènes sombres, prix élevé.
VA (Vertical Alignment) : contraste élevé (3000:1+), noirs profonds, couleurs saturées, angles de vision corrects, temps de réponse historiquement lent (aujourd'hui corrigé sur modèles gaming), smearing potentiel (traînée en mouvements rapides). Idéal pour gaming immersif et multimédia.
Notre iiyama VA offre le meilleur compromis. Le contraste 3000:1 donne des noirs bien plus profonds qu'un IPS (critique pour films et jeux sombres). Le temps de réponse 0,6 ms MPRT (avec overdrive) élimine le ghosting. L'incurvation 1500R (rayon de 1,5m) enveloppe la vision périphérique naturellement.
Inconvénient VA : léger color shifting en angles extrêmes. Sur un 34", assis normalement, non visible. Si vous bougez à 60° de chaque côté de l'écran, oui, les couleurs changent. Mais pourquoi feriez-vous ça ?
120 Hz et FreeSync Premium : Fluidité Garantie
120 Hz signifie affichage de 120 images/seconde maximum. Comparé au 60 Hz standard, différence majeure en gaming : mouvements fluides, input lag réduit, réactivité améliorée. Pour du travail bureautique, 60 Hz suffit. Pour gaming/vidéo/scrolling web, 120+ Hz change la vie.
FreeSync Premium synchronise taux de rafraîchissement de l'écran avec FPS délivrés par la GPU. Résultat : élimination du tearing (déchirement image), du stuttering (saccades), du input lag. Fonctionne entre 48 et 120 FPS. En dessous de 48 FPS, LFC (Low Framerate Compensation) double les frames pour maintenir la fluidité.
Compatibilité G-Sync : AMD FreeSync et NVIDIA G-Sync utilisent désormais le même protocole (VESA Adaptive Sync via DisplayPort). Notre écran, certifié FreeSync Premium, fonctionne parfaitement avec les GPU NVIDIA RTX récentes. Si vous switchez vers NVIDIA dans trois ans, aucun souci.
Luminosité 500 cd/m² : Pour Environnements Lumineux
500 nits, c'est brillant. Écrans standards plafonnent à 250-350 nits. Pourquoi tant ?
Environnements lumineux : bureau avec fenêtre, lumière directe du jour. À 500 nits, contenu visible sans reflet. HDR aussi bénéficie (pics lumineux plus éclatants).
Attention : utiliser 500 nits en permanence = fatigue oculaire. Calibrez à 200-300 nits pour usage quotidien. Réservez le max pour HDR ou visionnage de films ensoleillé.
L'écran supporte HDR10, mais sans certification DisplayHDR (VESA). HDR fonctionnel, mais pas spectaculaire (zone dimming limitée). Pour HDR vraiment impressionnant, il faudrait un FALD (Full Array Local Dimming) à 1000+ nits et 1500+ euros. Notre usage ? HDR correct, sans plus.
Connectivité et USB Hub Intégré
DisplayPort 1.4 : utilisez ce câble (fourni) pour connecter votre GPU. DP 1.4 supporte 3440x1440@120 Hz sans compression. HDMI 2.0 limite à 100 Hz.
HDMI 2.0 (x2) : pour consoles (PS5, Xbox Series X), décodeur TV, second PC. Les consoles actuelles ne supportent pas 21:9 nativement (affichage 16:9 avec barres noires), mais c'est pratique pour Netflix/YouTube sur grand écran.
USB Hub : 2x USB 3.2 Type-A + 2x Type-C. Branchez le câble USB-C fourni entre écran et PC. Vous obtenez hub intégré pour clavier, souris, clé USB, téléphone. Rangement bureau amélioré (câbles vers écran, pas vers tour).
Type-C DP Alt Mode : les ports Type-C supportent DisplayPort alternatif. Connectez laptop moderne via unique câble Type-C : image + charge + hub USB simultanément. Très pratique pour setup hybride bureau/laptop.
Haut-Parleurs Intégrés : Mieux Que Rien
2x3W intégrés. Ne remplacent PAS des enceintes dédiées, mais dépannent :
- Visio-conférence sans casque
- Vidéo YouTube rapide
- Son système (notifications)
Qualité : correcte. Pas de basses, aigus nasillards, stéréo étroite. Utilisez des enceintes ou carte son pour contenu sérieux.
Pied Ergonomique : Confort Posturel
Réglage hauteur 15 cm = positionnement optimal selon taille. Haut écran doit aligner avec ligne des yeux. Inclinaison -5°/+20° compense reflets/posture. Swivel ±30° partage écran avec collègue/ami.
Base solide, pas de wobble. Montage VESA 100x100 si préférence bras articulé tiers.
Prix et Disponibilité : Investissement Pérenne
L'iiyama GB3482WQSU-B1 se vend à 249,90€ sur Amazon France. Excellent rapport qualité-prix pour un 34" ultrawide 1440p à 120 Hz avec cette luminosité et connectivité.
Concurrents directs :
- LG 34WP65C-B : similaire, IPS, 400 nits, 160 Hz, 480€ (bon aussi)
- Samsung Odyssey G5 : VA, 165 Hz, 1000R incurvé, 450€ (plus gaming pur)
- Dell S3422DWG : VA, 144 Hz, certification HDR400, 500€ (excellente alternative)
L'iiyama se démarque par luminosité 500 nits, hub USB complet, pied super-réglable, prix imbattable. Marque moins connue qu'LG/Samsung, mais qualité identique (iiyama fabrique depuis 1982, surtout marché professionnel européen).
Garantie : 3 ans constructeur. iiyama offre généralement politique pixel mort stricte (remplacement si >3 pixels morts ou 1 en centre).
Calibration et Profil ICC
Sortie d'usine, l'écran affiche sRGB étendu (~125% sRGB). Couleurs saturées, pas précises pour travail graphique professionnel. Solutions :
Mode prédéfini "sRGB" (dans OSD) : limite gamut à 100% sRGB, couleurs plus neutres.
Calibration hardware (avancé) : sonde colorimétrique (X-Rite i1Display Pro, ~250€) génère profil ICC personnalisé. Précision delta-E <1.
Pour notre usage (gaming, création amateur), mode sRGB suffit. Professionnels pré-presse : investissez dans sonde.
Périphériques : Clavier Corsair K95 RGB et Souris Konix Drakkar
Clavier Corsair K95 RGB Platinum : La Rolls du Gaming
Le Corsair K95 RGB Platinum est un monstre. Clavier mécanique full-size (pavé numérique inclus), switchs Cherry MX Speed (linéaires, actuation 1,2mm, rapides), châssis aluminium brossé, repose-poignets amovible en similicuir, 6 touches macro programmables.
Switchs Cherry MX Speed : point d'actuation ultra-court (1,2mm vs 2mm sur MX Red). Réactivité maximale. Linéaires = aucun clic tactile, silence relatif (comparé aux Blues clicky). Idéal gaming rapide (FPS, MOBA). Pour typage prolongé, certains préfèrent MX Brown (tactiles). Goût personnel.
Rétroéclairage RGB par touche : 16,8 millions couleurs, personnalisation via Corsair iCUE. Créez profils par jeu (WASD rouge pour FPS, QWER bleu pour MOBA). Effets vague, ripple, réactifs à frappe. Gadget ? Peut-être. Utile pour repères visuels en faible luminosité ? Oui.
6 touches G dédiées : programmez macros complexes (combos gaming, raccourcis Photoshop/Premiere). Plugin iCUE intègre certaines apps.
Qualité construction : chassis aluminium anodisé, rigide zéro flex. Câble USB tressé détachable (USB Type-A). Poids 1,4 kg (ne bouge pas en session intense).
Prix : 180-220 euros selon vendeur. Cher. Vaut-il le coup ? Si vous tapez/jouez 4+ heures quotidiennes, longévité et confort justifient. Alternative budget : Corsair K70 RGB (similaire, moins macros, 130 euros).
Critique : logiciel iCUE (contrôle RGB/macros) est parfois buggé, consomme RAM. Corsair améliore progressivement. Alternative logiciel-free : mode onboard memory (3 profils stockés clavier).
Souris Konix Drakkar : L'Outsider Ambidextre
Changement total de registre. La Konix Drakkar est une marque française confidentielle, positionnement budget. Souris gaming ambidextre (utilisable main droite OU gauche, rare).
Design symétrique : 2 boutons latéraux de chaque côté (4 total), grip caoutchouté, forme classique sans extravagance ergonomique. Parfait gauchers ou droitiers souhaitant alterner.
Capteur optique : 3200 DPI max, 4 paliers ajustables (800/1600/2400/3200). Fréquence polling 125 Hz (8ms). Honnêtement... médiocre pour gaming compétitif sérieux. Mais pour usage casual et bureautique ? Amplement suffisant.
RGB : logo illuminé 7 couleurs (cycles automatiques, pas personnalisables). Basique.
Câble USB tressé, switchs Huano (20 millions clics), poids ~90g.
Prix : 15-25 euros. Voilà pourquoi elle figure ici. Rapport qualité/prix imbattable pour usage général. Elle ne rivalisera jamais avec une Logitech G Pro X Superlight (150 euros), mais remplit sa fonction.
Critique : durabilité incertaine. Konix n'a pas l'historique qualité de Logitech/Razer. Attendez-vous à 2-3 ans de vie. Garantie 2 ans (vérifiez revendeur).
Alternative si budget permet : Logitech G502 HERO (75 euros, référence absolue) ou Razer DeathAdder V3 (70 euros, ergonomie droitiers).
Pourquoi Pas de Tapis de Souris Recommandé ?
Les tapis mousepad gaming coûtent 15-50 euros. Utiles ? Si vous jouez compétitif (FPS, RTS), oui : surface uniforme améliore précision tracking. Pour notre usage polyvalent ? N'importe quel tapis basique Amazon 10 euros suffit. Voire votre bureau si surface lisse.
Assemblage et Installation : Conseils Pratiques
Assembler un PC n'est pas sorcier. YouTube regorge de tutoriels (chaînes recommandées : Hardware Unboxed, JayzTwoCents, Linus Tech Tips français: Cowcotland, Materiel.net). Points critiques :
Ordre de Montage Optimal
- Préparez workspace : table dégagée, tournevis cruciforme magnétique, serre-câbles, pâte thermique ARCTIC MX-4 à portée.
- Installez PSU dans boîtier : ventilateur vers bas (aspire air extérieur), visserie fournie. Routez câbles principaux (ATX 24-pin, EPS 8-pin CPU, PCIe 8+8-pin) vers avant pour faciliter branchement.
- Préparez carte mère hors boîtier : posez sur carton anti-statique (fourni avec). Installez CPU (triangle repère coin), pâte thermique (grain riz centre), ventirad (suivez notice), RAM (slots A2/B2, clipsez fermement).
- Installez carte mère dans boîtier : entretoises (standoffs) pré-installées normalement dans HAF 500. Alignez I/O shield, vissez 9 vis (ne forcez pas, serrage modéré).
- Branchez alimentations : ATX 24-pin carte mère, EPS 8-pin CPU (haut gauche), PCIe 8+8-pin GPU (après installation). Connexions façade (USB, audio, power switch) selon manuel carte mère.
- Installez SSD/HDD : SSD 2,5" dans cage, HDD 3,5" avec amortisseurs. Câbles SATA vers carte mère + SATA power depuis PSU.
- Installez GPU : enlevez covers slots PCIe arrière. Insérez GPU dans slot PCIe x16 principal (premier sous CPU), clipsez, vissez bracket, branchez PCIe power.
- Cable management : regroupez câbles derrière carte mère, utilisez serre-câbles, cachez dans routing channel HAF 500. Airflow amélioré + esthétique propre.
- Fermez boîtier, branchez écran/clavier/souris, allumez : si ça boot au BIOS, 90% du travail fait !
Premiers Démarrages : BIOS et Windows
Au premier boot : entrez BIOS (touche DEL/F2 spam au démarrage). Vérifiez :
- CPU reconnu (Ryzen 5 9600X, 6 cores)
- RAM reconnue (16 Go, dual channel)
- Température CPU au repos (<40°C)
Activez profil XMP/EXPO (onglet Tweaker/OC) pour RAM 6000 MHz. Sauvez, redémarrez.
Installez Windows : clé USB bootable (Media Creation Tool Microsoft), installation sur SSD Samsung 870 EVO. 15 minutes.
Drivers :
- Chipset AMD (depuis site AMD)
- GPU Radeon (AMD Software Adrenalin Edition)
- Realtek audio (si carte son non utilisée)
- Pilotes carte mère Gigabyte (LAN, WiFi depuis site Gigabyte)
Mises à jour Windows : laissez tourner, redémarrage multiples possibles.
Logiciels essentiels :
- Navigateur (Firefox, Brave, Chrome)
- Suite bureautique (LibreOffice, MS Office)
- Compression (7-Zip)
- Média (VLC)
- Gaming (Steam, Epic Games)
- Création selon besoins (GIMP, DaVinci Resolve, Audacity)
Tests Stabilité et Température
Prime95 (stress CPU) : lancez 10 minutes. Température <85°C OK. Au-delà, vérifiez montage ventirad/pâte.
FurMark (stress GPU) : 10 minutes. Température <80°C OK. Bruit ventilateurs normal.
3DMark (benchmark gaming) : mesurez scores, comparez moyennes en ligne (vérifiez performance normale).
CrystalDiskMark (vitesse SSD) : vérifiez ~550 Mo/s lecture/écriture sur 870 EVO.
Budget Total et Récapitulatif
| Composant | Modèle | Prix (€) |
|---|---|---|
| Processeur | Ryzen 5 9600X | 195 |
| Pâte thermique | ARCTIC MX-4 | 7 |
| Carte mère | Gigabyte X870 EAGLE WIFI7 | 243 |
| RAM | Kingston FURY Beast 16 Go DDR5 6000 | 233 |
| GPU | XFX RX 7700 XT SWFT210 | 399 |
| Alimentation | Corsair RM750x | 130 |
| Ventirad | ARCTIC Freezer 34 eSports Duo | 50 |
| Boîtier | Cooler Master HAF 500 Blanc | 120 |
| SSD | Samsung 870 EVO 1 To | 80 |
| HDD | Seagate BarraCuda 2 To | 55 |
| Graveur BD | QDSYLQ USB 3.0 (pour les artistes) | 80 |
| Carte son | Creative Sound Blaster X4 (pour artistes) | 130 |
| Enceintes | Edifier R1380T | 70 |
| Moniteur | iiyama GCB3482WQSU-B1 | 249 |
| Clavier | Corsair K95 RGB Platinum (ou CORSAIR K55 RGB PRO à 58€ pour joueurs) | 200 |
| Souris | Konix Drakkar | 20 |
| TOTAL | ~2261 € |
Variations Selon Choix
- RM750x SHIFT (+40€) : 2610€
- Deepcool AK400 (-15€) : 2555€
- Sound Blaster GC7 (+110€) : 2680€
- Focusrite Scarlett 8i6 (+170€) : 2740€
- HDD 4 To (+40€) : 2610€
Configuration complète, performante, évolutive pour 2260 (voire 1900€ !)-2750 euros selon options. Dans le contexte 2026 avec mémoire explosive, c'est un prix honnête pour cette polyvalence.
Sans le graveur, sans la carte son et en uttilisant celle interne à la carte mère qui est très convenable et avec un clavier CORSAIR K55 RGB PRO, vous pouvez même réduire le prix de votre configuration de 350€ !
Évolutivité et Upgrades Futurs
Court Terme (fin 2026)
RAM : ajoutez 16 ou 32 Go quand prix redescendent. Passage à 32 Go total (~100€ en 2027 vs 280€ aujourd'hui).
Stockage : ajoutez NVMe 2 To pour bibliothèque jeux (~120€).
Moyen Terme (2027-2028)
GPU : RX 8800 XT ou RTX 5070 pour 4K gaming (~500€ probable).
CPU : Ryzen 9 9950X3D si besoins intensifs (~400€, simple swap sans changer carte mère).
Long Terme (2029+)
Nouvelle plateforme : si AM6 AMD ou socket Intel attractif, migration complète. Mais gardez boîtier, PSU, écran, périphériques (réutilisables décennie+).
Construire en 2025, un Acte de Foi Rationnel
Monter un PC en 2025 n'est pas l'exercice tranquille des années passées. La mémoire joue les divas capricieuses, les prix dansent la samba, et les prophètes de l'apocalypse PC hurlent dans le vent. Mais comme toujours dans l'histoire du hardware, les crises passent, le bon sens demeure.
Oui, payer 233 euros pour 16 Go de RAM qui en valaient 80 l'an dernier est frustrant. Mais refuser de construire pour autant serait céder au catastrophisme mercantile. Cette configuration prouve qu'avec choix judicieux et vision long terme, une machine polyvalente, performante et pérenne reste accessible.
Le Ryzen 9600X apporte efficacité et puissance pour années à venir. La RX 7700 XT délivre gaming 1440p ultrawide fluide et création accélérée. Le boîtier HAF 500 respire et durera trois builds. L'écran iiyama transformera votre expérience quotidienne pour une décennie. Et la plateforme AM5 garantit upgrades progressifs sans tout racheter.
Alors oui, assemblons. Modifions. Upgraderons. Refusons l'obsolescence programmée des consoles et l'enfermement des écosystèmes fermés. Le PC est mort ? Longue vie au PC.
Rendez-vous en 2027 pour la configuration suivante. Avec un peu de chance, on parlera enfin d'autre chose que de RAM hors de prix.
08:09 Publié dans Actualité, Station PC recommandée | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook | | |
Facebook | | | 
04/02/2026
Configuration PC 2026 recommandée (2/3)

Carte Graphique : XFX Speedster SWFT210 Radeon RX 7700 XT
AMD RDNA 3 : L'Alternative Crédible à NVIDIA
Le marché GPU est un duopole NVIDIA/AMD (Intel essaie avec les Arc, mais reste marginal). NVIDIA domine le segment haut de gamme avec les RTX 4080/4090, mais se fait plus agressif sur les prix depuis l'annonce imminente des RTX 5000. AMD, avec l'architecture RDNA 3, propose des cartes compétitives à meilleur rapport qualité/prix, surtout en rasterisation pure.
La XFX Speedster SWFT210 Radeon RX 7700 XT (référence RX-77TSWFTFP) incarne cette stratégie. Puce Navi 32, 54 CU (
Compute Units), 12 Go de VRAM GDDR6 sur bus 192-bit, fréquence boost à 2544 MHz. Performance globale proche d'une RTX 4060 Ti, mais avec 4 Go de VRAM supplémentaires (crucial pour les textures ultra en 1440p).
Performances Gaming en 1440p Ultrawide
Notre moniteur iiyama est un 3440x1440 (21:9), soit 4,9 millions de pixels. C'est 33% de plus qu'un 16:9 classique en 1440p (3,6 millions), mais 38% de moins qu'un 4K (8,3 millions). La RX 7700 XT excelle dans cette résolution :
- Cyberpunk 2077 (Ultra, sans ray-tracing) : 75-85 FPS
- Red Dead Redemption 2 (Optimisé) : 90-100 FPS
- Baldur's Gate 3 (Ultra) : 100-120 FPS
- Starfield (High) : 70-80 FPS
- The Last of Us Part I (High) : 80-95 FPS
En baissant quelques réglages peu impactants (ombres de Ultra à High, désactiver le motion blur inutile), on atteint facilement 100+ FPS dans la majorité des titres, profitant pleinement du 120 Hz de notre écran.
Ray-Tracing et FSR 3
Le ray-tracing AMD de génération actuelle reste inférieur à NVIDIA (RTX 4000 avec DLSS 3). Sur des jeux comme Cyberpunk 2077 ou Control avec ray-tracing activé, attendez-vous à 35-50 FPS. C'est jouable avec le FSR 3 (FidelityFX Super Resolution + Frame Generation), qui remonte à 70-80 FPS, mais avec légère perte de netteté et artefacts occasionnels.
Notre avis : en 2025, le ray-tracing reste un luxe. Les jeux restent magnifiques en rasterisation pure, et les 12 Go de VRAM garantissent fluidité et absence de stuttering. Dans trois ans, avec des cartes ray-tracing plus abordables, vous upgraderez. Aujourd'hui, cette RX 7700 XT fait le job brillamment.
Création de Contenu et Encodage
La RX 7700 XT brille en création :
- Encodage AV1 matériel : encodez vos vidéos YouTube 50% plus vite qu'avec l'encodeur CPU, qualité équivalente
- DaVinci Resolve : accélération OpenCL, rendu 4K fluide
- Blender Cycles : bon support des GPU AMD en rendering
- Adobe Premiere Pro : accélération Mercury Engine fonctionnelle
Petite limitation : certains logiciels (Premiere Pro, After Effects) sont historiquement plus optimisés pour CUDA (NVIDIA). Adobe améliore son support OpenCL, mais NVIDIA garde l'avantage. Pour un usage modéré, aucun souci. Si vous êtes monteur vidéo professionnel, une RTX 4070 serait plus pertinente (mais 200 euros plus chère).
Pourquoi XFX ? Design et Refroidissement
XFX produit des cartes AMD de qualité depuis des lustres. La série Speedster SWFT (prononcez "Swift", parce que XFX aime les orthographes créatives) se distingue par :
- Triple ventilateur de 90mm avec technologie "Ghost Blade" (pales incurvées pour airflow optimal et silence)
- Backplate en métal robuste avec découpe pour circulation d'air
- Dual BIOS : switch entre mode "Performance" et "Quiet" selon vos priorités
- RGB subtil sur le logo latéral (désactivable)
La carte reste sous 70°C en charge, ventilateurs tournant à 1400-1600 RPM (quasi-inaudibles derrière les ventilos du boîtier). Dimensions : 312mm de long, slot 2,5 (occupe 2,5 slots PCIe). Consommation : 245W en pic, connecteur PCIe 8+8 pins.
Prix et Disponibilité : L'Offre Bonus Jeu
Sur Amazon.fr, la XFX RX 7700 XT SWFT210 est vendue avec un jeu inclus (généralement un AAA récent comme Avatar Frontiers of Pandora ou Starfield). Prix constaté : 420-450 euros selon les périodes. Le jeu offert valorise l'achat de 60-70 euros supplémentaires.
Alternatives si rupture de stock :
- Sapphire Pulse RX 7700 XT : 430-460 euros, excellente aussi
- ASRock Challenger RX 7700 XT : 410-440 euros, design sobre
Évitez les modèles mono/dual ventilateur bas de gamme (température et bruit problématiques).
Cartes Son : Trois Solutions Selon Vos Usages
La Gigabyte X870 EAGLE WIFI7, malgré ses qualités, ne dispose que de 2 slots PCIe disponibles après installation du GPU. Les cartes son internes (Sound Blaster AE-7, ASUS Essence STX II) nécessitent un slot PCIe x1. Avec seulement deux slots, sacrifier l'un pour l'audio alors que des solutions externes existent serait idiot. D'où notre sélection de cartes son USB externes, qui offrent en prime mobilité et absence d'interférences électromagnétiques internes.
A) Creative Sound Blaster X4 : Le Joueur Polyvalent
La Sound Blaster X4 cible les gamers et créateurs occasionnels. DAC Hi-Res 24-bit/192kHz, connexion USB-C (câble USB-C vers USB-A inclus), compatibilité PC/Mac/PS5/Switch.
Points forts :
- Amplification casque jusqu'à 138 dB, compatible haute impédance (250 Ω et plus)
- Surround 7.1 virtualisé pour casques stéréo (technologie Creative SXFI, efficace pour l'immersion gaming)
- Entrées variées : optique, ligne, micro XLR avec alimentation fantôme 48V
- Contrôle matériel : molette de volume tactile, boutons personnalisables
- Logiciel Sound Blaster Command : égaliseur, profils audio par jeu
Super X-Fi : ATTENTION SCANDALE
Creative pousse sa technologie "Super X-Fi" (personnalisation du son 3D basée sur morphologie de tête/oreilles). Le concept est intéressant. L'implémentation est scandaleuse.
Pour activer Super X-Fi, vous devez :
- Télécharger l'app smartphone Creative
- Créer un compte (email + téléphone obligatoires)
- PHOTOGRAPHIER VOTRE VISAGE ET VOS OREILLES (!)
Oui. Creative exige des photos biométriques de vous. Les conditions d'utilisation mentionnent vaguement "amélioration de l'algorithme" et "stockage sur serveurs sécurisés". Aucune mention de durée de conservation, de revente potentielle à des tiers, ou de respect RGPD sérieux.
Notre position : refusez catégoriquement. N'activez jamais Super X-Fi. L'amélioration sonore est marginale (placebo pour la plupart), et le prix en vie privée est inacceptable. La X4 fonctionne parfaitement sans cette fonction. Logiciel Sound Blaster Command utilisable sans compte Creative (ouf).
Prix : 120-140 euros. Rapport qualité/prix excellent si vous ignorez le Super X-Fi. Pour du gaming standard et écoute musicale occasionnelle, c'est parfait.
B) Creative Sound Blaster GC7 : Streaming et Gaming Avancés
Le GC7 est le grand frère de la X4, conçu pour les streamers Twitch/YouTube. Mêmes qualités audio (DAC 24-bit/192kHz, ampli casque puissant), mais avec fonctionnalités supplémentaires :
- Écran OLED intégré affichant niveaux audio, égaliseur en temps réel, status des entrées
- Contrôles tactiles RGB pour volume, balance chat/game, commutation sources
- Deux entrées micro (XLR + jack 3,5mm) switchables instantanément
- Sortie ligne dédiée monitoring pour renvoyer le son vers table de mixage externe
- Logiciel avancé avec noise gate, compresseur, de-esser pour voix broadcast-ready
Super X-Fi présent également, donc même mise en garde : photos biométriques refusées, fonction ignorée.
Prix : 230-260 euros. Justifié si vous streamez régulièrement ou podcaster. Sinon, la X4 suffit.
C) Focusrite Scarlett 8i6 (3rd Gen) : La Référence Création Musicale
Si votre cœur balance vers la production audio, le Focusrite Scarlett 8i6 est votre Graal. Focusrite équipe 90% des studios amateurs et semi-pros mondiaux. La série Scarlett (rouge iconique) marie qualité professionnelle et abordabilité.
Spécifications techniques :
- Préamplis micro classe A avec gain élevé et bruit plancher extrêmement faible
- 8 entrées : 4x combo XLR/jack (dont 2 avec instrument hi-Z pour guitare/basse), 4x ligne TRS balancées
- 6 sorties : 4x ligne TRS + 2x moniteurs (pour enceintes studio)
- Alimentations fantômes 48V sur les 4 entrées XLR (micros à condensateur)
- Convertisseurs 24-bit/192 kHz avec plage dynamique de 116 dB
- Latence ultra-faible : 2,74 ms round-trip à 96 kHz (imperceptible)
- MIDI I/O pour claviers maîtres, contrôleurs
Logiciel inclus : pack gigantesque avec Ableton Live Lite, Pro Tools Intro, suite de plugins Softube (compresseur, égaliseur, saturateur). Valeur commerciale : 400+ euros.
Connectivité : les 4 entrées ligne supplémentaires acceptent claviers, synthés, boîtes à rythmes. Les 6 sorties permettent monitoring stéréo + renvoi vers matériel externe (compresseur hardware, réverb). Configuration complexe possible sans multiplication d'interfaces.
Qui en a besoin ?
- Musiciens enregistrant instruments/voix
- Producteurs utilisant hardware externe (synthés, drum machines)
- Podcasters multi-invités (4 micros simultanés)
- Sound designers nécessitant routing complexe
Qui n'en a PAS besoin ?
- Gamers (c'est overkill et les fonctionnalités ne serviront pas)
- Streamers solo (le GC7 suffit)
- Auditeurs musique passifs (la X4 ou carte mère interne suffisent)
Prix : 280-320 euros. Investissement sérieux, mais durable. Mon Scarlett 2i2 de 2015 fonctionne encore impeccablement.
Notre Recommandation Selon Profil
- Joueur casual + streaming musique : Sound Blaster X4
- Streamer/YouTubeur gaming : Sound Blaster GC7
- Musicien/producteur/podcaster : Focusrite Scarlett 8i6
Dans tous les cas, aucun Super X-Fi. Votre visage ne regarde que vous.
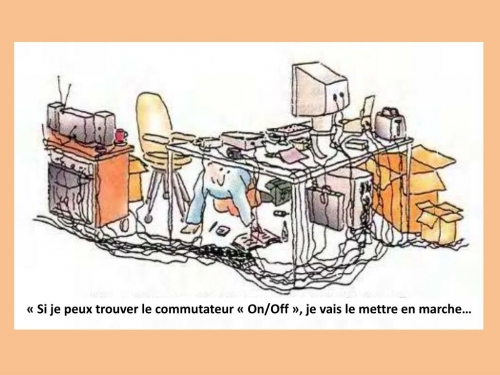
Enceintes : Edifier R1380T, le Classique Indémodable
Les enceintes actives Edifier R1380T traînent une réputation flatteuse depuis leur lancement en 2012. Après plus d'une décennie, pourquoi continuent-elles de figurer dans toutes les recommandations ?
Design et Construction
Enceintes bibliothèque classiques (bois MDF de 13mm), finition imitation bois (noir ou marron). Dimensions par enceinte : 24 x 15,4 x 19,6 cm. Grilles détachables en tissu. Look années 90-2000, assumé et élégant. Poids unitaire : 3,6 kg (ça ne bouge pas).
Acoustique
- Haut-parleur grave : 4" (10 cm) avec membrane en PP (polypropylène)
- Tweeter : 0,5" (13 mm) dôme soie
- Puissance RMS : 21W (11W + 10W)
- Réponse en fréquence : 55 Hz - 20 kHz
- Rapport signal/bruit : ≥85 dBA
Ces spécifications traduisent-elles une qualité sonore réelle ? Oui, étonnamment. Les médiums sont clairs, les aigus doux sans agressivité, les graves présents sans saturation (bien sûr, un caisson de basse apporterait du punch pour les explosions en jeu). Pour une pièce de 15-25m², volume d'écoute domestique, c'est impeccable.
Connectique et Contrôles
Enceinte gauche (active, avec ampli intégré) :
- 2x entrées RCA
- 1x sortie vers enceinte droite (câble fourni)
- Bouton volume rotatif avec LED
- Bouton basses/aigus (équaliseur basique)
Branchement simple : carte son (sortie ligne RCA) vers enceinte gauche, câble fourni vers enceinte droite. Aucune installation logicielle, ça marche immédiatement.
Prix et Disponibilité
60-75 euros la paire selon vendeur (Amazon, LDLC, Fnac). Rapport qualité/prix imbattable. Concurrents directs :
- Logitech Z623 : plus puissantes (200W), caisson de basse, mais qualité sonore médiocre (bourrinées)
- Creative Pebble V3 : design mignon, son ridicule
- PreSonus Eris E3.5 : meilleures (monitoring studio), mais 130 euros
Les Edifier restent le sweet spot pour usage multimédia généraliste.
Limites et Alternatives Future
Pour les audiophiles purs, les R1380T manquent de détails en haute définition (écoute FLAC 24-bit/192kHz). Si vous évoluez vers une écoute critique, envisagez :
- Edifier R1700BT (Bluetooth, meilleurs drivers) : 150 euros
- AudioEngine A2+ (référence compacte) : 280 euros
- JBL 305P MkII (monitoring professionnel) : 320 euros/paire
Mais pour notre config gaming/création, les R1380T font le job honorablement.
Stockage : Duo SSD + HDD Complémentaires
Stockage moderne = stratégie hybride. SSD pour l'OS et applications (vitesse), HDD pour archives (capacité/prix).
Disque SSD (C:) Samsung 870 EVO 1 To
Le Samsung 870 EVO est un SSD SATA, pas NVMe. Pourquoi ce choix alors que notre carte mère dispose de 3 slots M.2 NVMe ultra-rapides ?
Raison 1 : Rapport capacité/prix. Un SSD NVMe 1 To (Samsung 980 Pro, WD Black SN850X) coûte 120-150 euros. Le 870 EVO SATA ? 75-85 euros. Économie de 50 euros pour une différence de vitesse imperceptible en usage réel.
Raison 2 : Vitesse suffisante. SATA 6 Gbps = ~550 Mo/s en lecture/écriture séquentielle. NVMe 4.0 = ~7000 Mo/s. Sur papier, énorme différence. En pratique ? Windows démarre en 12s avec SATA vs 10s avec NVMe. Photoshop s'ouvre en 5s vs 4s. Les jeux chargent 2-3 secondes plus vite. Imperceptible.
Raison 3 : Fiabilité Samsung. Samsung fabrique ses propres contrôleurs, NAND flash et DRAM cache. Endurance TBW (Total Bytes Written) : 600 To. Garantie : 5 ans. Le 870 EVO est le SSD SATA le plus vendu mondialement depuis 2020.
Performances réelles :
- Lecture séquentielle : 560 Mo/s
- Écriture séquentielle : 530 Mo/s
- Lecture aléatoire 4K : 98K IOPS
- Écriture aléatoire 4K : 88K IOPS
Pour OS, logiciels, quelques jeux favoris (100-150 Go chacun), largement suffisant.
Plan d'upgrade futur : quand les prix NVMe baissent encore (attendu 2026), ajoutez un NVMe 2 To pour bibliothèque de jeux. Le 870 EVO reste en C: pour l'OS (pas besoin de réinstaller).
Disque Dur Stockage : Seagate BarraCuda 2 To (ST2000DMZ08)
Le Seagate BarraCuda 2 To est un classique : HDD 3,5", 7200 RPM, cache 256 Mo, SATA 6 Gbps. Prix : 50-60 euros. Capacité/prix : 0,025€/Go. Imbattable.
Usage idéal :
- Films, séries, musique (FLAC/MP3)
- Photos/vidéos brutes (backup avant montage)
- Documents, archives, ISO
- Jeux secondaires moins joués
Vitesse : ~200 Mo/s en lecture/écriture séquentielle. Lent comparé au SSD, mais pour du streaming vidéo local ou chargement de fichiers photo, aucun souci.
Fiabilité : la gamme BarraCuda est grand public (pas BarraCuda Pro ou IronWolf pour NAS). Attendez-vous à 3-5 ans de vie. Seagate offre 2 ans de garantie. Backup important : un HDD peut mourir. Ayez un disque externe USB pour données critiques.
Alternative 4 To : si 2 To semblent justes, le BarraCuda 4 To (ST4000DMZ04) coûte 90-100 euros. Excellente affaire si budget permet.
Graveur Blu-ray Externe : QDSYLQ USB 3.0/Type-C
Les graveurs optiques internes disparaissent (faute de slots 5,25" dans boîtiers modernes). Solution : externe USB. Le QDSYLQ Lecteur Blu-ray 50G (Amazon) est un graveur BD-RE polyvalent.
Spécifications :
- Lecture : CD, DVD, BD (simple/double couche)
- Gravure : CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE (jusqu'à 50 Go)
- Connexions : USB 3.0 Type-A + Type-C (2 câbles fournis)
- Vitesse : 6x BD, 8x DVD, 24x CD
- Compatibilité : Windows, macOS, Linux
Qui en a encore besoin en 2025 ?
- Collectionneurs physiques (Blu-ray films, musique)
- Archiveurs paranoïaques (BD-R 50 Go durent 50+ ans théoriquement)
- Récupérateurs de vieux CD/DVD personnels
Pour 90% des utilisateurs, le streaming et stockage cloud suffisent. Mais avoir un lecteur externe offre flexibilité : gravure de sauvegardes, récupération de vieux fichiers, visionnage de Blu-ray achetés.
Prix : 70-90 euros sur Amazon. Cherchez coupons/promos, fluctue fréquemment.
Attention logiciel : Windows ne lit pas nativement les Blu-ray commerciaux (chiffrés AACS). Nécessite VLC + bibliothèque AACS (gratuit, légal dans certains pays, zone grise ailleurs) ou achat PowerDVD/WinDVD (payant). Alternative gratuite légale : MakeMKV pour ripper en fichier MKV.
Suite et fin dans quelque jours...
09:29 Publié dans Actualité, Station PC recommandée | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook | | |
Facebook | | | 
26/01/2026
Configuration PC 2026 recommandée (1/3)

Configuration PC Multimédia 2026 : L'Année de Tous les Dangers (et de Toutes les Opportunités)
Ou comment monter une machine polyvalente sans vendre un rein, malgré l'apocalypse RAM
Bienvenue dans la Tempête Parfaite
Chers lecteurs, amis bricoleurs du dimanche et guerriers du RGB, installez-vous confortablement. Cette année, notre traditionnel guide de configuration PC multimédia s'annonce... particulier. Non, rayez ça : historique. Parce qu'entre les hausses délirantes de certains composants, les prophètes de malheur annonçant la mort du PC gaming, et l'évolution schizophrénique du marché, 2025 restera dans les annales comme l'année où assembler son PC est devenu un acte de résistance autant qu'une passion.
Commençons par l'éléphant dans la pièce, celui qui trompette si fort qu'on l'entend jusqu'en Patagonie : la mémoire vive a triplé de prix en trois mois. Oui, vous avez bien lu. Triplé. Comme si les barrettes de RAM avaient soudainement été fabriquées en platine plutôt qu'en silicium. Les 32 Go de DDR5 que vous pouviez acheter pour 120 euros en octobre dernier ? Comptez désormais entre 300 et 400 euros pour la même chose. Et non, ce n'est pas une blague de mauvais goût concoctée par un commercial sadique après trois verres de whisky.
Cette flambée spectaculaire s'explique par un cocktail détonnant : tensions géopolitiques en Asie, concentration oligopolistique du marché de la mémoire (Samsung, SK Hynix et Micron se partagent le gâteau), problèmes d'approvisionnement en matières premières, et – soyons honnêtes – une bonne dose de spéculation opportuniste. Quand trois fabricants contrôlent 95% du marché mondial, difficile de parler de libre concurrence. Les accusations de cartel et d'entente sur les prix refont surface régulièrement, avec des amendes qui tombent... puis tout recommence.
Mais respirons un grand coup. Ce n'est pas la première fois que la mémoire PC s'envole comme un ballon d'hélium lâché par un enfant distrait. Les vétérans se souviendront de 2017-2018, où les prix avaient déjà doublé, voire triplé. Puis de 2013, et avant encore de 2011. À chaque fois, le même scénario : panique, pleurnicheries, articles alarmistes... et retour à la normale après 12 à 18 mois. Les analystes sérieux – pas les YouTubeurs clickbait qui vivent de vos angoisses – prévoient une stabilisation des tarifs dès la fin 2026, une amélioration progressive en 2027, et un retour complet à la normale fin 2027-début 2028. Samsung et Micron augmentent déjà leurs capacités de production, et l'arrivée de nouveaux acteurs chinois sur le marché devrait accélérer la détente.
La Fable de la Mort du PC Gaming : Démontage d'une Prophétie Auto-Réalisatrice
Pendant que la RAM joue au yo-yo tarifaire, un concert de lamentations s'élève : "Le PC gaming est mort !", "C'est la fin d'une époque !", "Achetez plutôt une PlayStation 5 Pro à 800 euros !". Arrêtez tout. Respirez. Et maintenant, réfléchissons deux minutes.
Cette rhétorique apocalyptique n'est pas nouvelle. Elle ressurgit cycliquement depuis... eh bien, depuis que les consoles existent. On l'a entendue avec la PS2, la Xbox 360, la PS4, et maintenant la génération actuelle. À chaque fois, les mêmes arguments : "Les consoles sont moins chères", "Tout marche out of the box", "Pas de prise de tête avec les drivers". Et à chaque fois, le PC gaming non seulement survit, mais prospère.
Pourquoi ? Parce que ces discours catastrophistes servent des intérêts bien précis. Commençons par les fabricants de consoles : Sony, Microsoft et Nintendo ont tout intérêt à vous convaincre que leur écosystème fermé est l'alpha et l'oméga du jeu vidéo. Ils gagnent de l'argent non seulement sur le hardware (enfin, pas toujours, les consoles sont souvent vendues à perte), mais surtout sur les abonnements en ligne obligatoires (PlayStation Plus, Xbox Game Pass), la commission de 30% sur chaque jeu vendu, et l'impossibilité de modifier ou upgrader votre machine. Un PC, lui, ne vous facture pas 60 euros par an juste pour jouer en ligne. Étrange, non ?
Ensuite, les éditeurs de jeux. Beaucoup préfèrent les consoles pour une raison simple : le contrôle. Sur console, impossible de modder les jeux, difficile de contourner les DRM invasifs, et les joueurs sont captifs d'un store unique. Sur PC, Steam, Epic, GOG et autres se font concurrence (avec des prix parfois ridicules pendant les soldes), les mods prolongent la durée de vie des jeux gratuitement, et les joueurs sont... libres. Horresco referens !
Enfin, avouons-le : certains médias spécialisés adorent les titres anxiogènes. "Le PC gaming se porte bien" ne génère pas de clics. "LA FIN DU PC GAMING EST PROCHE – ANALYSE CHOC" fait grimper l'audimat. Le sensationnalisme nourrit son homme, comme disait mon grand-père qui ne parlait pourtant jamais de hardware.
La réalité ? Le marché du PC gaming croît chaque année. En 2024, il a représenté plus de 40 milliards de dollars, contre 35 milliards en 2020. Steam compte plus de 130 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Les eSports se jouent massivement sur PC. Et surtout, un PC n'est pas qu'une machine à jouer : c'est un outil de création, de travail, de streaming, de montage vidéo, de modélisation 3D. Votre PlayStation fait-elle tourner Blender, DaVinci Resolve ou Ableton Live ? Non. Affaire classée.
Oui, la hausse de la RAM complique temporairement les choses. Oui, les cartes graphiques haut de gamme coûtent un rein. Mais avec des choix judicieux – et c'est précisément l'objet de cet article –, on peut encore monter une configuration polyvalente, performante et évolutive pour un budget raisonnable. Alors rangez vos mouchoirs, on va construire quelque chose de beau.
Philosophie de Cette Configuration : Polyvalence, Performance, Pérennité
Avant de plonger dans le vif du sujet, clarifions notre approche. Cette configuration n'est ni un monstre de gaming pur, ni une workstation de professionnel à 5000 euros, ni un PC de bureau pour consulter ses mails. C'est une machine polyvalente pour les particuliers qui aiment créer (montage vidéo, retouche photo, musique, streaming) ET jouer occasionnellement ou régulièrement, sans nécessairement viser le 4K à 240 FPS avec ray-tracing maximal.
Les priorités :
- Créativité d'abord : capacité à gérer de l'encodage vidéo, de la production audio, du graphisme
- Gaming ensuite : jouer confortablement en 1440p ultrawide à 100+ FPS sur la majorité des jeux récents
- Évolutivité : possibilité d'upgrade progressif (RAM, GPU, stockage)
- Qualité sonore et visuelle : parce qu'on ne vit qu'une fois, et que le son crachotant et l'écran minable, c'est fini
- Silenciosité : on veut travailler et jouer, pas habiter dans un datacenter
Avec la crise de la mémoire, nous avons fait des choix stratégiques. Plutôt que 32 Go hors de prix, nous partons sur 16 Go de qualité, facilement doublable quand les tarifs redeviendront humains. L'argent économisé va vers des composants qu'on ne change pas tous les quatre matins : une excellente carte mère, une alimentation premium, un boîtier spacieux, et surtout un moniteur exceptionnel qui vous servira une décennie.
Le Cœur Battant : Processeur AMD Ryzen 5 9600X
Pourquoi AMD, et Pourquoi Maintenant ?
Le Ryzen 5 9600X incarne l'équilibre parfait entre performance et raison. Six cœurs Zen 5, douze threads, fréquence boost jusqu'à 5,4 GHz, et un TDP de seulement 65W qui lui permet de rester d'un calme olympien même sous charge. AMD a frappé fort avec cette génération Zen 5 : IPC (Instructions Per Cycle) amélioré de 16% par rapport au Zen 4, efficacité énergétique digne d'un moine bouddhiste, et compatibilité avec le socket AM5 qui garantit des années d'upgrade potentiel.
Comparé à la concurrence Intel (Core i5-14600K), le 9600X consomme moitié moins d'énergie à performance équivalente. Moins de chaleur = moins de bruit = moins de facture électrique = plus de budget pour le reste. En création de contenu, il dévore l'encodage vidéo grâce à ses instructions AVX-512 et son architecture moderne. En gaming, il ne bride aucunement notre RX 7700 XT, même en 1440p ultrawide.
Cerise sur le gâteau : avec la sortie imminente des Ryzen 9000X3D (avec cache V-Cache pour les gaming addicts), les prix des 9600X classiques ont légèrement baissé. On trouve des deals entre 250 et 280 euros, ce qui en fait une affaire remarquable pour le rapport performance/prix.
Pâte Thermique ARCTIC MX-4 : Le Détail qui Change Tout
Ne négligez JAMAIS la pâte thermique. Celle fournie avec les ventirad est généralement médiocre, pré-appliquée de manière aléatoire, et sèche en deux ans. L'ARCTIC MX-4 est devenue une référence pour de bonnes raisons : conductivité thermique excellente (8,5 W/mK), longévité exceptionnelle (plus de 8 ans sans sécher), non-conductrice électriquement (aucun risque de court-circuit en cas de débordement), et prix dérisoire (environ 7 euros les 4 grammes).
Elle fait baisser les températures de 3 à 7°C par rapport aux pâtes bas de gamme. Sur un processeur qui turbo-boost en fonction de sa température, ces quelques degrés peuvent signifier 100 à 200 MHz supplémentaires en permanence. Appliquez une quantité de la taille d'un grain de riz au centre du processeur, le ventirad étalera tout seul lors du montage. Évitez la méthode "tartine de Nutella" chère aux débutants enthousiastes.
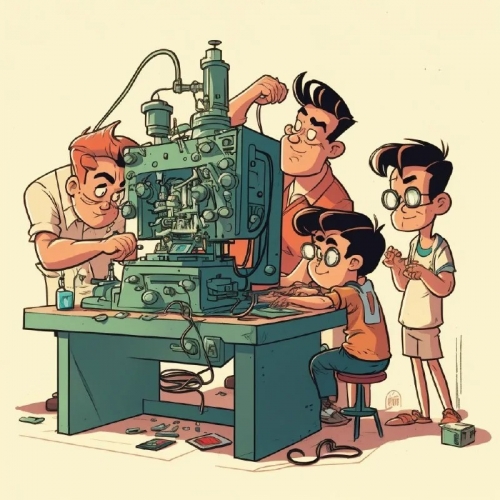
L'Alimentation : Corsair RM750x (ou RM750x SHIFT pour les Perfectionnistes)
Pourquoi 750W ? Pourquoi Corsair ?
Certains penseront : "750W, c'est exagéré pour cette config !". Détrompez-vous. Notre système consommera effectivement entre 350 et 450W en charge maximale (RX 7700 XT : ~250W, Ryzen 9600X : ~90W, reste du système : ~80W). Alors pourquoi 750W ?
Raison 1 : La courbe d'efficacité. Les alimentations PSU sont plus efficaces entre 40% et 80% de leur capacité. À 400W, notre RM750x tourne à 50% de charge, soit son point d'efficacité optimal (certification 80+ Gold). Elle convertit alors plus de 92% de l'électricité en courant utilisable, gaspillant moins d'énergie en chaleur. Une alimentation de 550W à 80% de charge serait moins efficace, plus chaude, plus bruyante.
Raison 2 : La marge d'upgrade. Dans deux ans, vous voulez passer à une RX 8800 XT ou une RTX 5080 ? Avec 750W, vous êtes couverts. Vous voulez ajouter des disques, des ventilateurs RGB débiles, un AIO watercooling ? Pas de souci.
Raison 3 : La longévité et le silence. Une alimentation qui ne force jamais reste silencieuse. La RM750x dispose d'un mode semi-passif où son ventilateur ne tourne même pas en dessous de 300W de charge. Imaginez : un PC quasi-inaudible en navigation web ou en bureautique.
La Corsair RM750x est un pilier du marché depuis des années. Composants japonais de qualité (condensateurs Nippon Chemi-Con), protection complète (OCP, OVP, UVP, SCP, OTP – tout l'alphabet des sécurités), câbles gainés, garantie 10 ans. Elle coûte environ 120-130 euros, ce qui est honnête pour ce niveau de qualité.
RM750x SHIFT : L'Excellence pour 40 Euros de Plus
Si vous assemblez vous-même votre PC (et vous devriez, c'est gratifiant), considérez sérieusement la RM750x SHIFT. Elle reprend les qualités de la RM750x standard, mais avec des améliorations subtiles qui font toute la différence :
- Connecteurs latéraux : les câbles sortent sur le côté plutôt qu'à l'arrière, facilitant le câble management dans les boîtiers modernes
- Ventilateur de 135mm encore plus silencieux
- Vibrations réduites grâce à des amortisseurs améliorés
- Certification 80+ Gold encore plus stricte avec efficacité supérieure à 94% à charge moyenne
Prix : environ 160-170 euros. L'investissement vaut-il le coup ? Si vous gardez votre PC 5-7 ans (ce qui devrait être le cas avec cette config), ces 40 euros supplémentaires s'amortissent en économies d'électricité, en silence, et en tranquillité d'esprit. Mais la RM750x standard reste excellente si le budget est serré.
Carte Mère : Gigabyte X870 EAGLE WIFI7
Le Socle de Tout l'Édifice
Une carte mère, c'est comme les fondations d'une maison : invisible, sous-estimée, mais critique. La Gigabyte X870 EAGLE WIFI7 coche toutes les cases nécessaires sans tomber dans l'excès bling-bling RGB qui fait exploser les prix.
Chipset X870 : le haut de gamme pour socket AM5, avec support complet du PCIe 5.0 pour le GPU et le stockage, USB 4.0, et capacités d'overclocking poussées (même si notre 9600X se débrouille très bien en stock). Comparé au B650, le X870 offre plus de lanes PCIe, de meilleurs VRM pour la stabilité électrique, et une pérennité accrue.
VRM de qualité : phase d'alimentation 16+2+1 avec dissipateurs thermiques généreux. Les VRM (Voltage Regulator Modules) convertissent les 12V de l'alimentation en tensions utilisables par le CPU (~1V). Des VRM de mauvaise qualité surchauffent, throttle le processeur, et réduisent la durée de vie. Ici, même avec un futur Ryzen 9 9950X, aucun problème.
WiFi 7 : oui, le WiFi 7 vient tout juste de sortir. Oui, votre box Internet ne le supporte probablement pas encore. Mais dans 2-3 ans ? Vous serez contents de l'avoir. Débits théoriques jusqu'à 46 Gbps (contre 9,6 pour le WiFi 6E), latence ultra-faible, et meilleure gestion des environnements encombrés. En attendant, elle fonctionne parfaitement en WiFi 6E ou WiFi 6. Si vous préférez l'Ethernet (toujours supérieur pour le gaming), port 2,5 GbE présent.
4 slots DIMM DDR5 : on installe nos 16 Go aujourd'hui (2x8 Go en dual channel pour performance optimale), et on ajoute 16 ou 32 Go supplémentaires quand la RAM redeviendra abordable. Maximum supporté : 192 Go (vous n'en aurez jamais besoin, mais c'est rassurant).
Connectivité moderne :
- 3x M.2 PCIe 4.0 pour SSD (un avec dissipateur thermique intégré)
- 6x SATA pour nos disques classiques
- USB-C 20 Gbps en façade et arrière
- DisplayPort et HDMI (inutiles avec GPU dédié, mais pratiques en dépannage)
Petit hic : seulement 2 slots PCIe disponibles après installation du GPU. Cela explique notre choix de cartes son externes plutôt qu'internes. Gigabyte aurait pu faire mieux, mais à ce prix (280-320 euros selon les promos), difficile de bouder.
Le BIOS Gigabyte Q-Flash Plus permet de flasher le BIOS sans CPU installé, pratique si AMD sort un nouveau processeur nécessitant une mise à jour. L'interface UEFI est claire, en français, avec modes "Easy" et "Advanced" selon votre niveau. Rien à redire.
Un Mot sur le Socket AM5 et la Pérennité
AMD a promis de supporter le socket AM5 jusqu'en 2027 minimum. Cela signifie que dans deux ans, si vous voulez upgrader vers un Ryzen 10000-series, simple échange du processeur. Pas besoin de changer carte mère, RAM, refaire toute l'installation. Intel, de son côté, change de socket tous les deux ans comme de chemise, vous forçant à tout racheter. Merci AMD pour cette bouffée de rationalité.
Refroidissement : ARCTIC Freezer 34 eSports Duo vs Deepcool AK400
Le Ryzen 9600X génère peu de chaleur (65W TDP, pics à ~90W), mais mérite quand même un ventirad correct pour rester silencieux et booster efficacement. Nous proposons deux options selon votre climat.
ARCTIC Freezer 34 eSports Duo : Pour les Régions Chaudes
Si vous vivez dans le sud de la France, en Corse, à La Réunion, ou tout endroit où l'été transforme votre bureau en sauna, l'ARCTIC Freezer 34 eSports Duo est votre ami. Deux ventilateurs de 120mm en push-pull, tour thermique en aluminium avec 4 caloducs de 6mm en contact direct avec le CPU, hauteur de 157mm (compatible avec la plupart des boîtiers).
Il maintient le 9600X sous 65°C en charge intensive, même par 35°C ambiant. Les ventilateurs BioniX P-series sont PWM (régulation automatique selon température), avec paliers fluides (longévité de 100 000 heures) et silencieux (23 dBA à vitesse nominale). Prix : environ 50 euros. Look "gamer" avec touches de couleur (disponible en blanc, noir, jaune, vert), mais sobre comparé aux excès habituels.
Deepcool AK400 : Efficacité et Silence pour Climats Tempérés
En région parisienne, Bretagne, Nord, ou climats tempérés, le Deepcool AK400 suffit amplement et coûte moins cher (35-40 euros). Tour thermique classique, 4 caloducs, un ventilateur de 120mm PWM. Performances légèrement inférieures à l'ARCTIC (70°C en charge par 25°C ambiant), mais parfaitement adéquates pour notre usage.
Son avantage ? Le silence absolu. Le ventilateur FDB (Fluid Dynamic Bearing) produit à peine 21 dBA à pleine vitesse, et oscille entre 15 et 18 dBA en usage normal. C'est moins bruyant que le ronronnement d'un chat. Design noir élégant sans RGB inutile.
Les deux ventirad supportent largement l'overclocking modéré si jamais vous vous sentez d'humeur aventureuse. Installation simple sur AM5 avec système de fixation par backplate. N'oubliez pas d'appliquer votre ARCTIC MX-4 avant montage !
Le Boîtier : Cooler Master HAF 500 Blanc, Cathédrale du Hardware
Ah, le boîtier. Sujet de discordes infinies entre minimalistes et RGB-addicts, entre partisans du silence et fétichistes de l'airflow. Le Cooler Master HAF 500 (High Air Flow 500) en blanc opale tranche le débat : c'est une cathédrale spacieuse, aérée, accessible, et magnifique.
Design et Construction : Quand l'Ingénierie Rencontre l'Esthétique
La série HAF de Cooler Master existe depuis 2009 (le HAF 932 était légendaire). Le HAF 500 en est l'héritier moderne. Dimensions : 544mm (H) x 240mm (L) x 542mm (P). Oui, c'est grand. Non, ce n'est pas un problème : votre bureau n'est pas un studio parisien de 9m².
Façade mesh : contrairement aux boîtiers vitrés de tous côtés qui transforment votre PC en four, le HAF 500 respire. Maillage métallique fin sur toute la façade, permettant une aspiration maximale d'air frais. Résultat : composants 5 à 10°C plus froids qu'avec un Corsair iCUE vitré, ventilateurs tournant moins vite, silence amélioré.
Panneau latéral en verre trempé : d'accord, on peut admirer nos composants. Le verre est fumé légèrement, élégant, avec charnières et verrous magnétiques facilitant l'ouverture. Pas de visserie fastidieuse, un simple "clac" et le panneau se dépose. Pratique pour le nettoyage trimestriel (vous nettoyez votre PC, n'est-ce pas ?).
Intérieur spacieux : clearance CPU cooler jusqu'à 176mm, GPU jusqu'à 405mm, gestion de câbles facilitée par 32mm d'espace derrière la carte mère. Un routing channel avec cache amovible permet de guider tous les câbles proprement. Même un débutant obtiendra un résultat propre en suivant les guides YouTube.
Support ventilateurs :
- Façade : 3x 140mm ou 3x 120mm
- Haut : 3x 140mm ou 3x 120mm (avec radiateur jusqu'à 360mm si AIO watercooling)
- Arrière : 1x 140mm ou 1x 120mm
- Côté : 2x 140mm (optionnel)
Cooler Master inclut 3 ventilateurs 140mm ARGB en façade et 1x 140mm ARGB à l'arrière. C'est suffisant pour notre config. L'airflow positif (plus d'air entrant que sortant) minimise l'accumulation de poussière.
Stockage et Connectique : Le Pragmatisme Avant Tout
- 8 emplacements SSD 2,5" avec cages métalliques amovibles
- 2 emplacements HDD 3,5" avec amortisseurs anti-vibration (parfait pour notre BarraCuda)
- Panneau I/O frontal : 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (10 Gbps), 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (10 Gbps), audio combo jack, bouton LED. Ergonomique, accessible, bien positionné.
Le RGB : Optionnel et Contrôlable
Les ventilateurs ARGB sont contrôlables via le bouton frontal (10 modes de couleurs) ou via la carte mère (connexion ARGB standard 3-pin). Si le disco vous horripile, un clic désactive tout. Si au contraire vous assumez votre côté festival EDM, synchronisation possible avec le reste des composants RGB via Gigabyte RGB Fusion.
Prix et Disponibilité
Le HAF 500 blanc se trouve entre 140 et 160 euros selon les revendeurs (LDLC, Amazon, Materiel.net). Investissement judicieux : un bon boîtier dure trois builds successifs. J'utilise encore un Fractal Define R5 de 2015, aucune raison de changer. Le blanc est subjectif (certains préfèrent le noir discret), mais apporte une touche de fraîcheur bienvenue dans un univers dominé par le noir/gris.
Seul regret : absence de filtres à poussière magnétiques ultra-faciles sur le haut. Ceux présents sont bons, mais nécessitent de démonter la façade. Cooler Master, si vous nous lisez...
Mémoire : Kingston FURY Beast 16 Go DDR5 6000 MHz CL30
Le Dilemme de 2025
Parlons franchement. En temps normal, cette configuration mériterait 32 Go de RAM. Pour du montage vidéo 4K, de la modélisation 3D, ou simplement Chrome avec 47 onglets ouverts (on ne vous juge pas), 32 Go permettent de respirer. Mais nous ne sommes pas en temps normal.
Avec le triplement des prix, un kit 2x16 Go de DDR5 6000 MHz CL30 coûte actuellement 280 à 350 euros. C'est INSENSÉ. Pour mettre en perspective : le même kit valait 100-120 euros en octobre 2024. Payer trois fois plus pour le même produit n'est pas rationnel quand on sait que les prix redescendront.
Notre stratégie : 16 Go maintenant (2x8 Go), 16 ou 32 Go supplémentaires plus tard. Pour 80-100 euros, le kit Kingston FURY Beast 2x8 Go DDR5 6000 MHz CL30 offre un excellent rapport qualité/prix. Kingston est un fabricant fiable, les timings CL30 sont serrés (bonne réactivité), et 6000 MHz est le sweet spot pour les Ryzen 9000 (contrôleur mémoire optimisé pour cette fréquence).
16 Go, Est-Ce Suffisant en 2025 ?
Pour le gaming : oui, largement. La majorité des jeux récents consomment 8 à 12 Go. Quelques titres mal optimisés (Cities Skylines 2, Star Citizen) peuvent approcher 16 Go, mais restent jouables. Fermez Discord, Chrome et Spotify avant de lancer, et tout roule.
Pour la création :
- Retouche photo (Photoshop, GIMP) : 16 Go suffisent pour 90% des usages. Les fichiers RAW de 50 megapixels peuvent tirer la langue, mais restent gérables.
- Montage vidéo 1080p/1440p (DaVinci Resolve, Premiere Pro) : 16 Go fonctionnent, avec limitation sur le nombre de pistes et d'effets en temps réel. Pour du 4K multi-caméras, 32 Go deviennent nécessaires.
- Musique (Ableton, FL Studio) : 16 Go vont bien, sauf projets monstrueux avec 50 VST simultanés.
- Modélisation 3D (Blender) : dépend de la complexité. Une scène simple OK, un modèle de ville complète avec textures 4K non.
L'astuce : Windows et les applications modernes utilisent la mémoire disponible de manière opportuniste. Avec 32 Go, ils en utilisent 25. Avec 16 Go, ils en utilisent 13 et compressent/swappent intelligemment le reste. Ce n'est pas idéal, mais fonctionnel.
Dual Channel et Performance
CRITIQUE IMPORTANTE : achetez impérativement 2 barrettes de 8 Go (dual channel), jamais une seule de 16 Go. Le Ryzen 9600X en dual channel offre 25 à 30% de performances supplémentaires versus single channel. En gaming, cela se traduit par 15-20 FPS de plus. En création, encodage et rendu accélérés.
Installez les barrettes dans les slots A2 et B2 (généralement les slots 2 et 4 en partant du CPU), comme indiqué dans le manuel de la carte mère. Activez le profil XMP/EXPO dans le BIOS pour garantir la fréquence 6000 MHz (par défaut, la RAM tourne à 4800 MHz).
Plan d'Upgrade Futur
Quand les prix redeviendront raisonnables (espérons fin 2026), ajoutez simplement deux barrettes identiques (Kingston FURY Beast 8 Go DDR5 6000 CL30) dans les slots A1 et B1. Vous passez instantanément à 32 Go quad channel. Si Kingston a cessé ce modèle, n'importe quel kit DDR5 6000 CL30 fonctionnera (privilégiez la même marque pour compatibilité optimale).
Alternative future : vendez le kit 16 Go et achetez un kit 2x32 Go. Avec la baisse attendue, 64 Go pourrait coûter le prix actuel de 32 Go. Anticiper, c'est gagner.
La suite dans quelques jours...
08:59 Publié dans Actualité, Station PC recommandée | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook | | |
Facebook | | | 








